Censée moderniser son image, la chaîne américaine de restaurants Cracker Barrel a déclenché une véritable tempête en dévoilant un nouveau logo au design épuré. L’intention était claire : séduire une clientèle plus jeune et coller aux tendances graphiques actuelles. Mais c’était sans compter la mobilisation des milieux conservateurs américains… et l’intervention directe de Donald Trump.
Face à la polémique grandissante, l’enseigne du Tennessee a annoncé, ce 26 août, qu’elle abandonnait son nouveau logo pour revenir à l’ancien. « Nous avions dit que nous écouterions et nous l’avons fait », a déclaré Cracker Barrel sur X. En une journée, la marque est passée d’un rebranding assumé à une capitulation totale face à la pression politique et populaire.
Besoin d'une
agence créative ?
- Stratégie / Campagne 360°
- Accompagnement social media
- Activation virale
- Visibilité garantie



Un changement de logo qui met le feu aux poudres
Mi-août, Cracker Barrel avait révélé un nouvel emblème minimaliste : un simple mot-symbole sur fond jaune foncé, débarrassé de son icône historique. Exit l’image de “Tonton Herschel”, figure emblématique assise sur son tonneau, symbole de l’ADN traditionnel de la chaîne. Mais cette modernisation n’a pas du tout séduit une partie des Américains.
Rapidement, les cercles conservateurs et les soutiens de Trump ont dénoncé une « marque woke » prête à renier son héritage pour séduire une clientèle progressiste. Sur les réseaux sociaux, les attaques se sont multipliées : Donald Trump Jr. s’est indigné sur X, des comptes militants comme “Woke War Room” ont accusé l’entreprise de « supprimer une esthétique que les Américains aimaient » et des élus républicains ont fustigé une “réinvention imposée”.


Trump entre dans la bataille et change la donne
Alors que la polémique prenait de l’ampleur et que l’action de Cracker Barrel chutait de plus de 10 % en Bourse, Donald Trump est monté au créneau. Sur sa plateforme Truth Social, le président américain a exhorté la marque à « revenir au vieux logo, admettre son erreur » et profiter de ce qu’il a appelé « un milliard de dollars en publicité gratuite ».
Quelques heures plus tard, Cracker Barrel annonçait officiellement le retour à son emblème historique, saluant la fidélité de ses clients et réaffirmant son statut de « fière institution américaine ». En réponse, Trump a félicité la chaîne, estimant qu’elle avait pris « la bonne décision ».
Un cas d’école sur le poids de la politique dans le branding
Au-delà d’une simple affaire de design, cette controverse illustre la puissance des mobilisations politiques dans l’économie de l’image. En tentant de moderniser son identité visuelle, Cracker Barrel visait une nouvelle génération de clients… mais s’est heurtée à la force symbolique de son patrimoine auprès d’une base conservatrice fidèle.
Finalement, le pari du minimalisme a coûté cher : entre bad buzz, pression des sphères MAGA, menaces de boycott et volatilité boursière, la marque a préféré la prudence. Et ironie de l’histoire : après l’annonce du retour à l’ancien logo, le titre Cracker Barrel a bondi de 6,35 % à Wall Street, validant de facto la victoire des conservateurs.
Cracker Barrel:
— Mike Lee (@BasedMikeLee) August 27, 2025
Adopting the world’s first moving logo—with its own soundtrack! pic.twitter.com/YO0g5qOqhP
Depuis l’échec retentissant du rebranding de Jaguar, campagne jugée trop « woke », perçue comme déconnectée de son ADN et à l’origine du départ de son PDG après une chute des ventes en Europe, les marques adoptent désormais une approche ultra-prudente lorsqu’il s’agit de modifier leur image.
Aux États-Unis, une tendance « anti-woke » sécrète s’impose dans le marketing. La campagne de American Eagle avec Sydney Sweeney, jeu de mots entre « jeans » et « genes », en est l’illustration parfaite, entre controverses autour des standards esthétiques, coup de com’ viral et pic temporaire du cours de l’action, sans pour autant générer un retour concret sur les ventes en magasin.




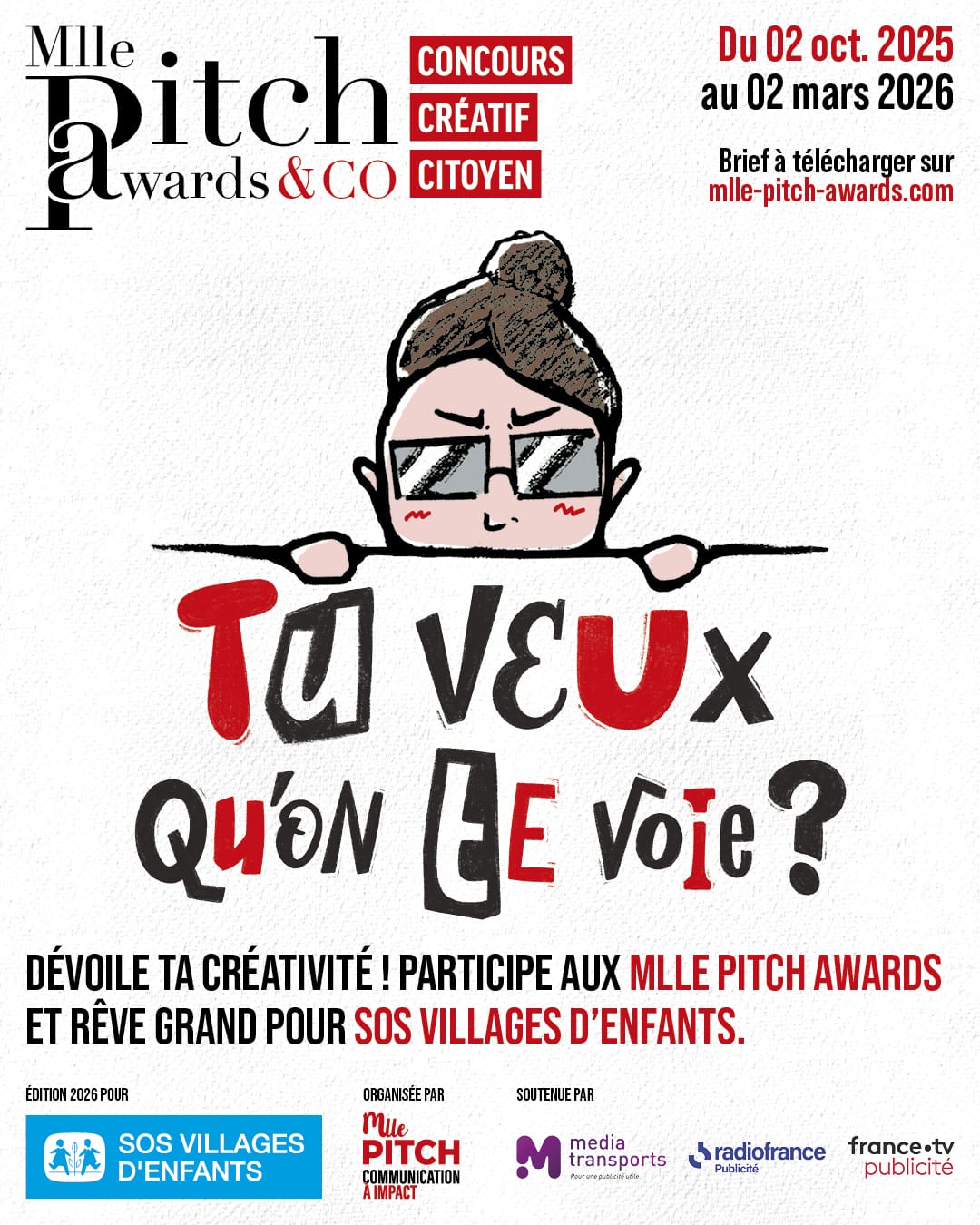


Go woke go broke.
A force les marques vont peut-être finir par comprendre…